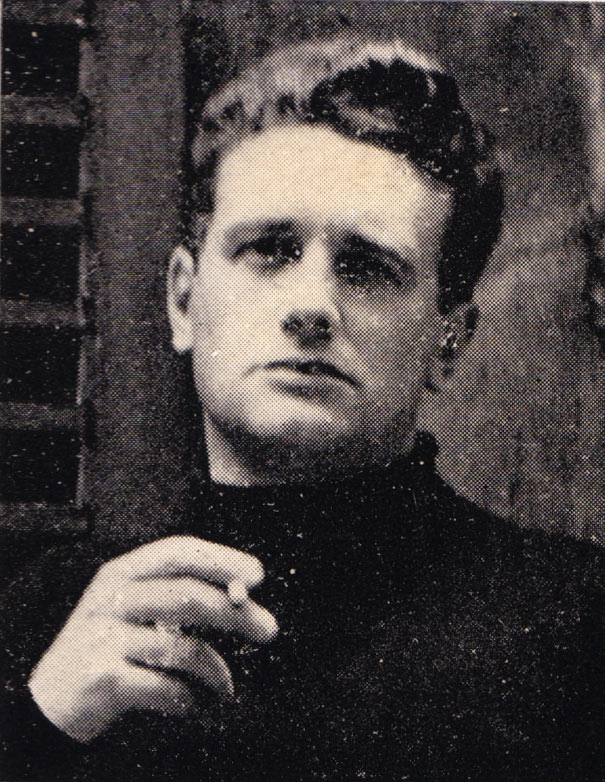BLOODY MAMA, ROBERT THOM
BLOODY MAMA, ROBERT THOMSÉRIE NOIRE # 1373, 1970
Roger Corman chez Marcel Duhamel, série B en Série Noire, novélisation du film éponyme par son scénariste Robert Thom - pas encore signataire de Death Race 2000 mais déjà bien barré - ce n'est pas l'Histoire avec un grand H, respectueuse, véridique, et tout le toutim, à laquelle nous sommes conviés mais bien à une fantasmagorie exploitative pourvue de grosses burnes et d'une écriture joliment volage.
Coup de semonce en page 8 - " Votre auteur est Dieu " - et Dieu l'auteur, dans un style très new thing californienne, de nous raconter alors la vie grandeur nature et bigger than life de Kate 'bloody mama' Barker et de ses quatre fils, loustics fort peu recommandables, rustres sanguinaires, criminels du middle-west, monstres plus qu'humains.
En pleine ère des ennemis publics et autres gangsters vedettes made in U.S. of A., les Barkers mère et fils dévalisent des banques, kidnappent des gens, tuent des flics et prient le seigneur avant d'aller au lit.
"À ton avis, Maman, fit Herman, est-ce que Dillinger est plus célèbre que nous, ou est-ce qu'on est plus célèbre que lui ?"Il y a des entêtes de chapitres qui se veulent futées et qui bien souvent y arrivent. Il y a de la baise incestueuse entre membres de la famille Barker. Il y a la drogue qui abruti Lloyd. Il y a la violence des uns et le sexe des autres. (" comme si les bêtes fauves de la jungle..." prélude un protagoniste dans son pauvre petit crâne.) Il y a Freddie qui ressemble à une fille et qui se fait enfiler par ses ainés. Il y a Mona la morue qui écrème les plus lubriques, rêve des stars du grand-écran et se peinturlure les lèvres à longueur de temps.
"Tu vois ?... D'être gangster, ça a ses avantages. On s' soucie pas des règles qu'observent les gens bien."La chronique familiale ressemble à un long cauchemar, avec ses flous et ses blancs, ses instants de vides et ses moments de contemplation. C'est du Nouvel Hollywood à la machine à écrire, du vrai, du pur.
Une jeune sirène se fait enlever. Séquestrée, noyée dans la salle d'eau, elle ne dure que le temps d'un chapitre et ressemble à une parenthèse enchantée.
D'autres bribes, en vrac : un noir se fait lyncher puis sert de balançoire aux frangins, un tenancier de speakeasy devient marmelade sanguinolente à grands coups de bottes dans la nuque. L'ultra-violence se banalise et le cinéma muet trépasse.
Dans Bloody Mama, il n'y a ni prise de conscience ni crise d'hystérie, c'est un panoramique sur une folie douce en groupe, une famille de toquée qui vit constamment entre deux braquages, deux séjours en cage, deux veillées de camp et les chansonnettes populaire qui vont avec - " Va chercher ton cal'bar, j'vais chercher mon falzar " - " Trempe ta brosse dans la lumière du soleil et n'arrêtes pas de peindre " - " T'as les mirettes à fleur de tête " - " Appelez ça de la folie, moi j'appelle ça de l'amour."
Le bouquin peut sembler anecdotique et les faits qu'il relate sont presque toujours factices mais cela fait tout le sel de la chose.
D'ailleurs, puisqu'on cause anecdote, en voici une récente : en 2011, un exemplaire original de ce livre a été saisi dans une bouquinerie néo-zélandaise par le Departement of Internal Affair du coin. Car là-bas, ça fait plus de 40 ans que Bloody Mama est interdit à la vente.
Il y est jugé indécent.
De quoi s'établir fermement une situation sulfureuse.
Alors lisez-le, c'est banni !
Et puis, comme l'affirme Ma Baker en page 153 :
" Les gangsters, on les adore ! Tu sais pas qui on est, mais crois-moi, on nous adore. Tu crois que j' l'ai pas vu dans les journaux ? Au ciné ? Paul Muni. Et ce gars-là, Cagney ? À la radio ! [...] Moi... Moi et mes associés... on nous admire universellement ! Tout l' monde lit nos aventures ! Si on donnait notre adresse, je recevrais plus de lettre d'admirateurs que Mme Eleanor Roosevelt ! "Parole de M'man.